Dans quelques semaines, Marwan Muhammad, emblématique ancien porte-parole du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et actuel directeur exécutif, a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son mandat. C’est donc une page cruciale du CCIF qui se tourne depuis la création de l’association, il y a plus de treize ans. A cette occasion, l’auteur de « Nous (aussi) sommes la nation » nous a accordé un entretien-fleuve qui restera dans les annales et dans lequel il revient sur tout le chemin accompli par l’ONG, ses choix stratégiques, sa gestion des tensions politiques françaises mais aussi les circonstances dans lesquelles il s’est lui-même engagé au CCIF et les moments forts qu’il y a vécu. Un bilan historique que vous propose en exclusivité Mizane Info.
Mizane Info : Vous allez quitter le CCIF après sept années d’engagements intenses. Le CCIF perd donc un deuxième cadre important après le départ de son fondateur et président Samy Debah. N’est-ce pas un coup dur pour l’association ?
Marwan Muhammad : C’est plutôt un signe de santé et de vitalité. Une association est en fragilité lorsqu’elle ne peut pas, justement, se passer de l’un de ses cadres ou que le simple départ d’une personne fait péricliter un projet ou une démarche. Or, le CCIF, plus de treize ans après sa création, est suffisamment solide et a suffisamment de membres impliqués pour pouvoir se passer de l’un(e) d’entre eux. C’est l’une des plus grosses réussites de l’association : la qualité de son travail, de sa structure, de ses membres et non d’une personne en particulier. C’est aussi un signe de maturité de la part de ses cadres, comme ce fut le cas avec Samy Debah, de se dire « voilà, j’ai apporté ma contribution et pour le bien de l’association il faut être capable de passer le relai ». Cela crée aussi de l’espace, du renouvellement. Des personnes vont pouvoir proposer de nouvelles choses et apporter leur propre contribution. C’est l’une des richesses du CCIF : parmi tous les postes à responsabilité, que ce soit au service juridique, à la communication ou au management de l’équipe, tout le monde a eu des apports et des compétences professionnelles très différents. Samy Debah, le professeur d’histoire, féru de sciences politiques et de citoyenneté, qui arpente le terrain associatif depuis près de trente ans, n’a pas le même apport qu’un statisticien, un artisan, un chef d’entreprise ou une avocate. Mais tous sont utiles à la même cause. J’espère en avoir fait partie.
Quels étaient précisément vos objectifs ?
Le fait que le CCIF soit pérenne et autonome financièrement. Qu’il ait une parole forte et audible, rationnelle et accessible. Qu’il ait suffisamment de soutien, de la part de musulmans comme de non musulmans, d’hommes ou de femmes, quel que soit leur parcours, afin d’avoir une assise large, un soutien massif sur le terrain, qui renforce sa légitimité, tout en lui offrant les moyens de son travail et de son indépendance. Que le CCIF soit également ancré dans le paysage national et international, comme une association incontournable dans la lutte contre les racismes. Tout cela est dans une large mesure bien engagé. Il y a encore des enjeux de pédagogie et de prévention à mettre en œuvre dans la communication du CCIF, cela fera partie des grandes missions qui vont reposer sur les épaules de mon/ma successeur-e. Mais il n’y a plus d’enjeu de notoriété ou de visibilité du CCIF, encore moins d’indépendance.
Sur votre page Facebook, vous vous êtes expliqué sur d’autres raisons qui vous ont poussé à ne pas renouveler votre mandat. Vous écrivez « Arrêter quand je le peux, plutôt que quand je le dois ». Vous écrivez également : « Quand j’ai commencé à avoir une vie publique, j’ai vite réalisé les dangers que cela représentait : l’omniprésence des égos, la perte possible de sincérité, le regard des autres et la quête de reconnaissance, d’une part une admiration et des compliments souvent hors de proportion, de l’autre le ressentiment et les rancœurs personnelles ». Craigniez-vous une personnalisation du CCIF autour de votre figure ou le renforcement d’une telle tendance à la personnification ?
Bien sûr. Ce risque est inhérent à toute prise de parole publique. Simplement, c’était la première fois que nous avions une structure associative à ce niveau d’efficacité opérationnelle et de visibilité, une structure autonome, plurielle, professionnelle dans son travail et qui nous appartenaient collectivement. Nous apprenions aussi au fur et à mesure que nous menions les projets. La leçon de ne pas personnaliser les luttes est une chose importante dont nous avons hérité et dont nous avons essayé de nous inspirer. Il faut essayer de trouver le bon équilibre : les causes doivent être incarnées sans être personnalisées. Les luttes importantes sont incarnées par des êtres humains qui ont des forces, des fragilités, des faiblesses, des qualités mais aussi des défauts. C’est cela qui fait que l’on a envie de s’impliquer et de participer à ce qui est une aventure humaine, d’abord et avant tout.
L’antiracisme depuis la Marche pour l’Egalité de 1983 n’avait été qu’un vaste hold-up de la part de deux ou trois associations qui ont confisqué la parole des premiers concernés et qui, à coup de subventions, les avaient dépossédés de cette lutte
Les gens qui viennent soutenir le CCIF viennent parfois pour des raisons claires et objectives, des raisons quelquefois utilitaires, et parfois aussi parce qu’il se passe quelque chose d’humain, quelque chose de beau et de fort. C’est également parce que Lila Charef (cadre historique du CCIF, responsable du pôle juridique, ndlr) est une personne exceptionnelle et qu’elle est entourée d’une équipe qui ne l’est pas moins, que lorsque quelqu’un appelle le service juridique, il bénéficie d’une écoute attentive et bienveillante, ou qu’au cours d’une conférence ou d’une rencontre, un lien humain se crée. Néanmoins, que ce soit dans mon temps de porte-parole entre 2010 et 2014 ou en tant que directeur exécutif durant les deux dernières années, j’ai toujours essayé de mettre les gens en situation de responsabilité et de faire qu’ils ne se reposent pas uniquement sur les membres du CCIF, en se demandant ce qu’eux-mêmes peuvent faire pour participer.
Vous avez également écrit être « rentré au CCIF par accident » et y être « resté par responsabilité ». Comment s’est passé au juste votre rencontre avec le CCIF ?
J’ai fait connaissance avec le CCIF tout juste avant qu’il ne soit fondé en 2003. Je venais de finir mes cours et je me préparais à partir travailler au Japon pour la Société Générale. Je me suis retrouvé un soir avec des amis autour d’un dîner et, parmi les sujets de conversation, le fait qu’un certain nombre de femmes étaient devenues l’objet de discours racistes et de discriminations islamophobes, face auxquelles elles ne trouvaient pas d’aide. C’est ainsi qu’a été évoqué la genèse du CCIF autour de militants de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise qui souhaitaient créer une association. Etant moi-même sur le départ à ce moment-là, je ne m’étais pas senti concerné. Je portais alors un regard distant sur le militantisme, celui qu’une partie du monde professionnel et de la finance porte vis-à-vis du monde associatif. Ce n’est que plusieurs années plus tard, en 2010, qu’un ami avec lequel j’étais resté en contact m’a transféré une demande de bénévolat du CCIF pour traduire un discours en anglais. Pour faire ce travail, j’avais dû lire des rapports d’activité du CCIF et lorsque j’ai été confronté à cette réalité, à ces chiffres et à l’ampleur des actes islamophobes, je n’ai pas pu détourner le regard et passer à autre chose. J’ai proposé alors au CCIF d’améliorer la gestion et la présentation statistique de leurs chiffres. De fil en aiguille, je me suis impliqué de plus en plus.
Vous avez affirmé par ailleurs que le CCIF a « fait bouger les lignes de la lutte contre le racisme ». Qu’entendiez-vous par-là ?
Nous avions l’impression que les domaines de compétences et les pratiques professionnelles étaient disjointes entre le monde de l’entreprise, les institutions et le monde militant, avec à chaque fois des manières de faire différentes. Au CCIF, nous ne voyions pas de frontières entre ces domaines de compétences. Nous n’avions aucune objection à appliquer un certain nombre de méthodes professionnelles dans le milieu associatif, en faisant un constat critique lorsque c’était nécessaire tout en proposant des solutions pour résoudre les problèmes et ne plus seulement vivre avec. Nous avons donc cherché à appliquer dans le domaine de la lutte contre l’islamophobie des pratiques de l’ordre du consensus ou de la résolution de conflits en entreprise. Nous avons fait bouger les lignes dans notre façon de faire en communiquant de manière planifiée, en préparant des éléments de langage, en anticipant les réactions des journalistes ou en nous donnant la possibilité de choisir nos participations et de ne plus les subir. Ces frontières organisationnelles entre ces différents mondes étaient artificielles et nous avons essayé de les supprimer autant que possible. Les gens ne cessent pas d’être ce qu’ils sont et n’abandonnent pas leurs convictions lorsqu’ils mettent les pieds dans leur entreprise, dans la rue ou dans une association. On a essayé de concilier cela.
On peut dire que l’émergence du CCIF a bousculé l’univers clos de l’antiracisme institutionnel…
Un nouvel acteur qui apparaît sur la scène, qui gagne ses procès, qui est efficace médiatiquement et jouit d’une légitimité auprès des personnes qu’il défend, cela bouscule forcément le monde de l’antiracisme. Un activiste d’extrême-droite m’avait fait cette remarque en off : « Jamais un Arabe ne nous avait parlé comme ça ! ». Cela dit quelque chose de clair : quand les premiers touchés par une forme d’intolérance prennent en main leur condition, cela crée forcément une onde de choc. L’antiracisme depuis la Marche pour l’Egalité de 1983 jusqu’au milieu des années 2010 n’avait été qu’un vaste hold-up de la part de deux ou trois associations qui ont confisqué la parole des premiers concernés et qui, dopées à coup de subventions, les avaient dépossédés de cette lutte.
Au bout du compte, il n’y a pas moins de racisme en 2017 dans la société française qu’il n’y en avait dans les années 1980 ! Si on laisse faire cet antiracisme de l’inanité, les premiers concernés seront toujours à la place de spectateurs de leurs propres procès, tandis que d’autres parlent à leur place et font obstruction à leur prise de capacité. Ce sont aussi ces lignes politiques que le CCIF a fait bouger.
Le CCIF est-il reconnu aujourd’hui en France comme un acteur légitime par l’Etat et par une partie de l’establishment ?
Toutes les institutions qui se positionnent en termes d’expertise ont d’excellentes relations avec le CCIF. C’est le cas du Défenseur des Droits avec lequel nous collaborons chaque semaine pour la résolution de certains dossiers ; de l’Observatoire de la laïcité qui rend des avis intéressants sur la gestion de la laïcité dans le monde du travail ; de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) auprès de laquelle le CCIF est auditionné régulièrement et qui tient compte de nos avis et de nos recommandations dans le cadre de son travail. Cela est valable y compris au sein des ministères ou des rectorats lorsqu’il y a une médiation ou une situation problématique sur laquelle on alerte et qui est prise en compte.
Prendre la parole pour soi-même, c’est faire un pas décisif dans sa propre émancipation
C’est au niveau de certains groupes politiques qu’il y a encore une opposition, pas uniquement au niveau de la reconnaissance de l’islamophobie en tant que phénomène mais aussi sur ce que peut représenter, pour elles, le pouvoir de parler pour nous-mêmes. En fait, quel que soit le sujet, qu’il soit islamophobe, négrophobe, à l’encontre des Roms ou des migrants… dès que des personnes ont la capacité d’influer sur leur propre vie, individuellement et collectivement, ils se soustraient au pouvoir et au contrôle politique qui jusque-là leur étaient appliqué. C’est pour cela qu’il y a un enjeu important autour de la parole des personnes concernées par le racisme. Cette parole est un acte de pouvoir, de capacité et de dignité. Prendre la parole pour soi-même, c’est faire un pas décisif dans sa propre émancipation. La lutte contre l’islamophobie ne fait pas exception à cela. Dès lors, nous avons clairement établi que la fête (raciste) était terminée et que nous allions nous-mêmes nous charger de mener cette lutte contre des injustices que nous vivons. Pas seuls, mais au cœur des choix et des moyen s qu’implique cette lutte.
Quels sont selon vous les facteurs qui expliquent la montée en puissance du CCIF ? Diriez-vous que le passage d’une stratégie du tout juridique à celle d’une présence active sur le terrain médiatico-politique où se jouait les débats aura été décisif ?
Je ne pense pas que la partie médiatisation et communication soit décisive autrement que pour se rendre disponible auprès des premiers concernés et faire un travail de pédagogie sur les stéréotypes. C’est utile mais pas décisif dans la réussite du CCIF. Ce qui a été décisif, c’est que dès le premier jour, ses fondateurs et ses équipes se sont mis dans une démarche de service et d’entraide envers des personnes victimes de discriminations ou de violence. Quelques soient les critiques qui peuvent nous être adressées, jamais personne ne remettra cela en question.
Pourtant d’autres structures qui fournissent la même démarche de service y compris dans d’autres domaines (caritatif, éducatif) n’ont pas rencontré le même succès ?
Parce que la nature du sujet auquel nous nous attaquons est conflictuelle, chargée d’émotions. L’islamophobie, c’est aussi un objet politique et médiatique qui aborde la condition des musulmans, la manière dont la diversité est considérée dans la société française, le rapport que nous entretenons collectivement avec le passé colonial et les populations qui en sont issues. Tout cela constitue donc en ce sens un nœud de tensions unique. En même temps, le public s’est rendu compte qu’une quinzaine de personnes travaillaient dans cette structure à plein temps, que des milliers d’adhérents la soutenaient, qu’elle développait une expertise juridique et statistique, qu’elle intervenait également dans n’importe quel quartier, université, mosquée ou association avec la même constance dans son discours, ce qui est nouveau, et donc cela a créé de l’intérêt, sur le fond du travail du CCIF.
Votre présence active sur les réseaux sociaux et la solidarité d’autres militants antiracistes ont tout de même crée un faisceau de convergence et une émulation autour du CCIF qui ont été un moteur et une rampe de lancement…
Cela a été utile et a surtout touché quelque chose qui avait trait à la dignité humaine. Nous pouvons être aussi forts que nous voulons, en tant qu’êtres humains nous avons des li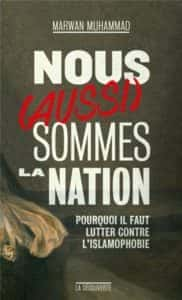 mites et nous avons donc besoin de croire en nous-mêmes, collectivement et individuellement. Voir des personnes qui parlent librement, qui relèvent la tête, avec rationalité et dignité sans avoir besoin de sacrifier les uns pour plaire aux autres est quelque chose de libérateur, d’inspirant. Dès que nous parlons de populations minoritaires, stigmatisées, victimes de racisme ou d’intolérance, l’enjeu de la représentation de soi au niveau individuel et collectif va être très importante. Confisquer la parole fait partie de l’oppression. Dès qu’une parole est restituée et qu’on peut s’y identifier, nous sommes dans un mouvement libérateur. C’est pour cette raison que la communication du CCIF est si importante. Nous n’avons jamais demandé à représenter qui que ce soit, mais nous sommes conscients que la manière dont on s’exprime traduit un peu plus que de la transparence associative : il y a aussi un enjeu de dignité et de reprise de la parole confisquée.
mites et nous avons donc besoin de croire en nous-mêmes, collectivement et individuellement. Voir des personnes qui parlent librement, qui relèvent la tête, avec rationalité et dignité sans avoir besoin de sacrifier les uns pour plaire aux autres est quelque chose de libérateur, d’inspirant. Dès que nous parlons de populations minoritaires, stigmatisées, victimes de racisme ou d’intolérance, l’enjeu de la représentation de soi au niveau individuel et collectif va être très importante. Confisquer la parole fait partie de l’oppression. Dès qu’une parole est restituée et qu’on peut s’y identifier, nous sommes dans un mouvement libérateur. C’est pour cette raison que la communication du CCIF est si importante. Nous n’avons jamais demandé à représenter qui que ce soit, mais nous sommes conscients que la manière dont on s’exprime traduit un peu plus que de la transparence associative : il y a aussi un enjeu de dignité et de reprise de la parole confisquée.
Comment avez-vous géré, à la fois dans vos orientations stratégiques et dans votre prise de parole, ce caractère central et incontournable de la dimension politique de l’action et du discours du CCIF qui demeure néanmoins et avant toute chose une association juridique, apolitique et engagée sur le terrain des droits de l’homme ?
Pour ma part, la stratégie de communication a été de restituer le travail et la pensée du CCIF, ses actions, son fonctionnement, les causes structurelles de l’islamophobie et les moyens de les résoudre. Voilà pour le contenu. Pour ce qui est du contenant, je me pose toujours la même question quand je prends la parole : à quel public je m’adresse ? En fait, on ne le sait jamais vraiment. Le public est tellement divers qu’il faut intégrer le fait qu’il peut y avoir dedans mon fils, mes parents, des musulmans et des non musulmans, des jeunes et des personnes plus âgées, des gens acquis à la cause du CCIF et d’autres qui y sont hostiles, des gens qui veulent se faire un avis et se posent des questions, des gens très investis religieusement et d’autres complètement athées. Ma parole, quelle qu’elle soit, doit pouvoir tous les atteindre de manière intelligible, transparente, simple sans être simpliste et sans jargon artificiel, ceci afin de pouvoir démonter les ressorts d’un discours qui a construit la différence comme un problème. C’est ce à quoi je me suis attelé.
La notion de lutte contre le racisme est liée à la notion de pouvoir (…) La prise de pouvoir réelle consiste à définir la vie que l’on souhaite mener
Ensuite, le CCIF est effectivement une association apolitique. Mais les questions sur lesquelles nous travaillons sont au centre du débat et de la vie politique. On voit également que la contribution des victimes de discriminations passe par leur implication dans les questions citoyennes mais au CCIF, nous envisageons cette implication de manière très ouverte. Nous comprenons que sur 100 personnes, il y a aura 100 manières différentes d’interagir avec la société. Certains ont fait de l’élection un enjeu central dans la participation politique, d’autres sont en rejet de cette forme de participation, d’autres encore vont être très actifs dans le milieu associatif et le milieu citoyen sur le plan local mais ne voudront pas voter par défaut. Lorsque l’on voit certains hommes politiques dirent : « Votez pour moi car je suis le moins pire », c’est un constat de mort politique totale qui explique largement les abstentions record auxquelles nous assistons.
Notre approche est donc pragmatique : s’il y a une trentaine d’actions possibles à mener dans la lutte contre l’islamophobie, alors que chacun choisisse celles qui sont cohérentes avec ses principes et ses opinions pour que tous fassent quelque chose d’utile. Plus chacun sera impliqué sur ces questions comme sur les grandes questions qui travaillent la société française (accompagnement des personnes âgées, échec scolaire, démantèlement des services publics, réchauffement climatique) moins il sera possible de problématiser ces personnes dans la mesure où elles feront tellement partie intégrante du tissu humain et citoyen qui insuffle la vie dans notre pays qu’il sera très compliqué de les mettre à l’écart.
Diriez-vous que la notion et la réalité de l’islamophobie jouissent à présent d’une reconnaissance publique ?
Oui, le débat sémantique est complètement dépassé. Cette bataille est établie, la notion d’islamophobie est incontournable. Ce qu’il faut continuer à faire, c’est de répéter les définitions du terme, d’être précis dans son usage. Bien sûr, il y a encore des personnes qui nient l’usage de ce terme d’islamophobie comme il y a des gens qui sont très attachés à leur minitel ou qui comptent en anciens francs ! La discussion porte maintenant sur les moyens et l’ampleur du travail à mener pour endiguer cette forme de racisme contemporain, avec quels partenaires mener ce travail et comment le conduire. La notion de lutte contre le racisme est liée à la notion de pouvoir. Des millions de personnes, Noirs, Arabes, Juifs, Roms, Asiatiques, fils ou filles de migrants, sont toutes victimes d’une forme de racisme contemporain : lorsque ces personnes sont mises en capacité de faire valoir leurs droits, de se mettre en chemin pour acquérir une égalité réelle, les lignes profondes de la société bougent avec une redistribution des cartes du pouvoir. A présent, ce sera une hypothèse envisageable de dire que le/la prochain-e président-e de la République sera peut-être né(e) à Montfermeil, fils de réfugié ou Rom et qu’il/elle pourra prétendre à un Prix Nobel d’économie ou aux plus hautes fonctions de l’Etat. Il s’agit pour nous de faire en sorte que nous soyons dans une égalité réelle et non dans un universalisme dévoyé, exercé en direction des quartiers populaires comme une charité civilisatrice, jamais vraiment débarrassée de ses travers postcoloniaux. La prise de pouvoir réelle consiste à définir la vie que l’on souhaite mener, puis à la réaliser en renouvelant constamment son intention.
La lutte contre l’islamophobie est confrontée à un autre obstacle et non des moindres : le terrorisme. La récurrence et la fréquence des attentats revendiqués par Daesh sur le sol européen alimente toute une propagande islamophobe opportuniste. De quelle manière le CCIF a-t-il décidé d’aborder cette question qui est toute à la fois sécuritaire, géopolitique et idéologique ?
La première chose est de ne pas avoir la moindre complaisance et de ne pas minimiser la gravité de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Même si lutter contre le terrorisme n’est pas dans notre mandat, le CCIF opère néanmoins dans un environnement où la lutte contre le terrorisme est une question centrale dans les enjeux sécuritaires, souvent abordés en lien (politique) avec les quartiers populaires et les populations noires, arabes et/ou musulmanes. Il ne suffit donc pas de dire « ce n’est pas mon mandat ou mon travail » pour que la question soit réglée, parce que cela a une influence sur notre travail, qu’on le veuille ou non. De fait, il y a un nouveau métier au CCIF, qui consiste à gérer les dérives collatérales de l’état d’urgence. Nous avons dû recruter des juristes supplémentaires pour travailler sur les perquisitions, les assignations à domicile et les interdictions de sortie du territoire abusives qui concernaient des personnes qui n’avaient strictement rien à voir avec le terrorisme. 430 dossiers ont été examinés.
L’islamophobie a fait de l’islam une substance dangereuse : « Plus on en consomme, plus on serait une personne dangereuse »
La manière dont sont affectées des populations musulmanes (ou supposées comme telles) ou supposées telles a basculé d’un enjeu de laïcité, de féminisme ou de liberté d’expression dévoyés vers un enjeu de sécurité dévoyée. Ce n’est plus seulement le discours islamophobe classique selon lequel « l’islam et les musulmans sont contraires aux valeurs et à l’identité du pays ». A présent, ce discours se décline sur le mode : « les musulmans sont un danger sécuritaire, si on les laisse s’organiser ». Ce discours a prise sur la société française. Face à cela, le CCIF agit sur deux plans. Un plan juridique méthodique où les dossiers sont traités un par un pour voir si les conditions et les motifs des perquisitions sont légitimes ou bien si elles reposent sur la simple islamité de la personne, considérée injustement comme un risque pour la sécurité du pays. En d’autres termes, est-ce que les services de sécurité s’intéressent à ce que les gens font ou à ce qu’ils sont, ce qui reviendrait à problématiser non leurs actes mais leur appartenance religieuse. L’islamophobie a fait de l’islam une substance dangereuse : « Plus on en consomme, plus on serait une personne dangereuse ».
C’est tout l’enjeu du débat sur la notion ambiguë de radicalisation…
Ce que l’on nomme abusivement la « radicalisation » va être assimilé faussement à un processus d’implication religieuse. Une personne serait coupable dès lors qu’elle serait investie dans un processus religieux, avec une gravité variant en fonction de son intensité. Or, en ayant injustement démoli la porte d’un domicile ou assigné à résidence des personnes, en leur faisant perdre leur emploi et en traumatisant leur famille, aucune sécurité supplémentaire n’a été assurée pour qui que ce soit. Des libertés fondamentales ont été mises en danger. Le second plan du travail du CCIF est de développer une expertise sur les moyens de lutter contre le terrorisme pour être force de proposition. La techno-sphère sécuritaire a réussi à implanter l’idée que plus de sécurité s’accompagne automatiquement d’une perte de libertés, ce qui est faux. Si on sacrifie l’une à l’autre, alors nous n’avons rien compris ni à l’une, ni à l’autre. Persécuter des gens par centaines, voire par milliers, a-t-il rendu la France plus sûre ? La réponse est non.

Très cyniquement, ces artisans de la techno-sphère et autres acteurs impliqués idéologiquement, nous mettent encore plus en danger, dans leur grille de lecture, en faisant très précisément ce qu’attendent les groupes terroristes, en misant sur une sécurité politique qui donnerait, en apparence, l’image d’un gouvernement très proactif au lieu d’une véritable sécurité qui serait discrète, ciblée, fluide et efficace. Au bout du compte, les recommandations du CCIF rejoignent l’expertise de très hauts fonctionnaires qui travaillent réellement sur la sécurité, à distance des discours politiques démagogiques, complètement improductifs et qui visent à satisfaire la frange la plus islamophobe de la population.
Lorsque vous leur dresser ce constat, que vous répondent concrètement les politiques ?
Ils disent deux choses : « J’ai bien compris, mais il faut quand même que je sois réélu ! » Ils sont conscients que dans une ville où se trouvent des quartiers populaires à reconquérir électoralement, les électeurs de l’extrême droite vont aller voter plus souvent aux élections que des Noirs, des Arabes ou des musulmans, au détriment desquels va s’exercer leur programme. Ils se disent : « Vous pouvez me détester mais vous n’allez pas voter, ce n’est donc pas très grave. Par contre l’électorat d’extrême droite, lui, va aller voter : il faut donc que je m’adresse à eux si je veux pouvoir grappiller les voix qui me manquent », estiment-ils. C’est un pur rapport de force électoral. Dès que les électeurs se mobiliseront, les lignes politiques bougeront d’elles-mêmes, par réalisme électoral. La deuxième chose est plus fine et plus juste : « Si le terrorisme est le produit d’un certain nombre de causes, contextuelles et structurelles, le résoudre va nous prendre au moins une génération pour résorber ces causes structurelles tout en luttant contre ses causes contextuelles. Et si nous sommes au top de notre efficacité, si les agents de police et de renseignement et les politiques sont vraiment exemplaires et que tout se déroule bien, il ne se passera strictement rien ! Tous ces efforts seront déployés pour que « rien » ne se passe, ce qui est précisément le résultat d’une bonne politique sécuritaire, mais c’est invendable politiquement car il n’y a pas de prime politique à la sécurité réelle ! » Et donc, de manière très démagogique, certains politiques se satisfont très bien du risque terroriste, car cela leur permet de jouer sur les peurs.
Au terme de votre engagement au CCIF, si vous aviez une fierté personnelle à exprimer sur votre travail, quelle serait-elle ?
Ce qui me rend le plus fier, c’est le taux de réussite dans la résolution des dossiers des personnes accompagnées par le CCIF. Un travail qui porte ses fruits et qui est de plus en plus soutenu. Nous recevons chaque année autour de 2000 demandes d’intervention dont 800 à 900 vont entrer dans les statistiques de l’islamophobie. Plus de 70 % de ces cas sont résolus soit par rappel de la loi, par médiation ou par action juridique.
Un grand échec survient lorsqu’une réussite individuelle parvient à masquer un échec collectif. J’espère que chacun de mes pas continuera d’être une réussite collective
Sinon, à titre personnel, je me souviens d’une anecdote où une mère était venue avec son enfant à une conférence, en province. Nous pensions que l’enfant n’était pas encore concerné par cette problématique mais sa maman nous a répondu : « Oui, mais je voulais qu’elle voit ce que c’est des êtres humains dignes ». Ça m’a touché. Une autre fois : voir par surprise mes parents dans le public d’une conférence et mesurer le chemin parcouru, c’est aussi un autre moment fort sur le plan humain. Mes parents m’ont compris et soutenu dans ce travail ce qui n’est pas forcément évident.
Et un regret ?
Il y en a. Peut-être celui de ne pas avoir compris tout de suite la nécessité de faire un gros travail de prévention et de comprendre que résoudre un dossier en amont pour s’assurer qu’il ne se reproduise pas l’année suivante revient à faciliter notre travail et éviter d’avoir à gérer ensuite des dossiers qui pourraient être évités si tout le monde y mettait du sien. Concrètement cela se traduit par un gros travail de sensibilisation, par exemple au ministère de l’Education ou de la Santé, un travail qui soit intégré dès la formation des personnels. Sur le plan personnel aussi, j’ai souffert d’avoir manqué de temps et d’avoir dû apprendre à dire « non » à tellement de personnes et de projets, pour ne pas accepter des responsabilités que je ne me sentais pas apte à porter. En tant qu’êtres humains, je réalise que nous sommes surtout des créatures de vulnérabilité.
Quels sont vos projets ? Qui va vous remplacer ?
Pour le moment, aucun projet précis à formuler. Dans le temps qui va suivre la fin de mon mandat au CCIF, je vais prendre un peu de repos et réenclencher ma machine à apprendre. Je vais m’occuper de ma famille, de mes proches, passer plus de temps à la cuisine et aux activités créatives ! Sur le plan professionnel, je l’ignore encore mais tout est ouvert. J’ai le luxe de pouvoir choisir ce que j’ai envie de faire. Et l’expérience du CCIF a été tellement riche et belle qu’elle m’a ouvert de nouveaux champs.
Pour mon remplacement, les choses ne sont pas encore définies, mais le poste est ouvert aux candidatures. Lila Charef (responsable du pôle juridique du CCIF) et Ibrahim Bechrouri (spécialisé sur les thématiques de sécurité) vont prendre en charge le porte parolat et chaque responsable de pôle gèrera la transition. Il n’y a aucune inquiétude à avoir sur la détermination des équipes du CCIF dans l’accomplissement de leur mission.
Vous avez écrit il y a quelques années : « Mes rêves et mes cauchemars, Mes peurs et mes espoirs, Sont rangés, classés, indélébiles dans ma mémoire ». Quel rêve et quel cauchemar avez-vous conservé ?
Je ne crois pas avoir beaucoup changé depuis mon enfance et mon adolescence. Je suis toujours à la fois précis, analytique et d’un autre côté profondément émotif et mélancolique. J’ai quelque chose en moi d’enfantin et je ne veux jamais perdre cela. Mon rêve est un projet : celui de continuer à faire des choses inspirantes et qui puissent toucher, en étant toujours auprès des gens que j’aime. J’ai un goût marqué pour les choses créatives et je vais sûrement continuer à explorer ça. Mon cauchemar et ma plus grande peur, c’est de perdre ma sincérité, d’oublier les raisons pour lesquelles je m’engage et de perdre mon discernement. C’est très difficile d’avoir le mot qu’il faut, de ne pas avoir un comportement froid et plat, de conserver un comportement humain et en même temps d’être juste. C’est la raison pour laquelle j’essaie régulièrement de renouveler mon intention, de prendre un peu de recul, d’avoir des phases de travail très intenses puis des phases de bilan, d’avoir aussi des personnes qui m’aident autour de moi lorsque j’en ai besoin et qui sont capables d’être en désaccord avec moi lorsque c’est nécessaire. Un grand échec survient lorsqu’une réussite individuelle parvient à masquer un échec collectif. Dans mon cas, j’espère que chacun de mes pas continuera d’être une réussite collective.
Propos recueillis par Fouad Bahri
A lire sur le même sujet :
–« Dictionnaire de l´islamophobie », Kamel Meziti











