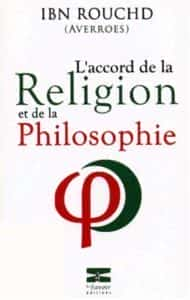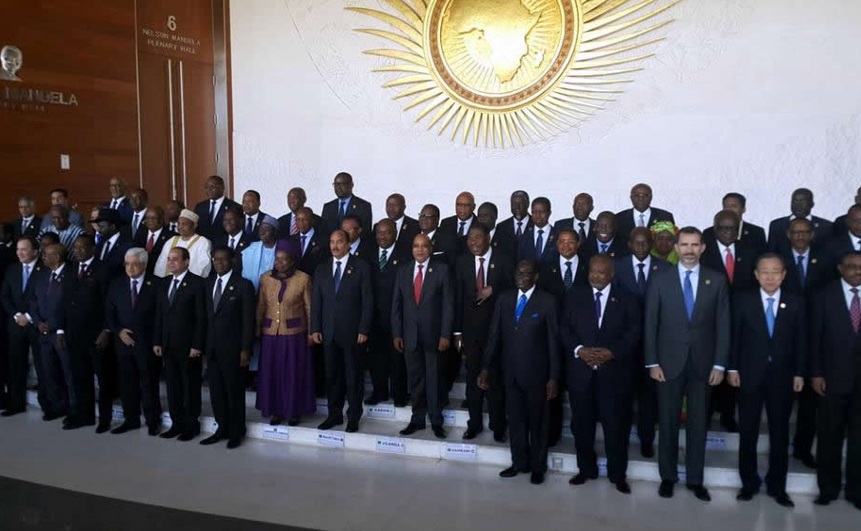Taha Abderrahmane.
Né en 1944, Taha Abderrahmane est un philosophe marocain et l’un des principaux philosophes et penseurs les plus influents du monde arabo-islamique. Ses travaux portent sur la logique, la philosophie du langage et la philosophie de la moralité. Enseignant et chroniqueur, Mouhib Jaroui nous présente dans un article exclusif publié par Mizane.info, quelques-uns des grands axes de sa pensée. Il met notamment en évidence les thèmes relatifs à la philosophie en terre d’islam, à la définition d’une modernité qui soit en accord avec la Tradition et à la méthodologie propre à la traduction.
Existe-t-il une philosophie arabe et musulmane ?
Le philosophe syrien George Tarabichi ouvre son chapitre, « L’impossible philosophie arabe », en disant qu’il faut « commencer par une vérité réelle : c’est qu’il n’existe pas de philosophie arabe moderne ou contemporaine, et s’il se trouvait une telle philosophie, elle n’est que traduction, ce qui est le cas du thomisme de Youssouf Karam, de l’existentialisme de Abderrahmane Badawi, le joanisme de Othman Amine, le personnalisme de Aziz Al-Habbâbî, le marxisme de Samir Amîne, le forbachisme de Hassan Hanafi ainsi que son husserlisme » (Hérésies I. Sur la démocratie, la laïcité, la modernité et l’obstination arabes, 3ème éd. 2011, p. 59).
Ajoutons à cette liste le positivisme logique de Zaki Naguib Mahmoud, l’obsession foucaldienne et derridienne de Ali Harb, Nasr Hamid Abou Zayd et Mohammed Arkoun, le marxisme de Abdallah al-‘Aroui, le kantisme et le bachelardisme de Mohammed Abed al-Jabri, l’hégélianisme de Mohammed Jâbir al-Ansârî, et la liste est longue.
Si l’on omet ces origines étrangères à la culture arabe et musulmane, que reste-t-il de cette philosophie ? A vrai dire, plus grand-chose. Au mieux, il reste l’adjectif de « penseur » avec le peu de considération qu’on lui témoigne aujourd’hui dans le monde arabe puisqu’on ferait désormais l’économie du statut de « philosophe ».

C’est ce que soulève l’écrivain irakien Fayçal Ghâzî Majhoul dans son ouvrage Sur la philosophie, la logique et la pensée arabe contemporaine, 2015, p. 382-383 : « Quant aux arabes actuels, ils n’ont pas qualifié Abderrahmane Badawi ou Fouad Zakaria ou Zaki Naguib Mahmoud ou une dizaine d’autres comme eux de « philosophes ».
Admettons qu’ils n’aient pas fait plus que traduire ou adopter une idée ou la transmettre ou la simplifier ou écrire sur la philosophie, ne méritent-ils quand même pas d’être qualifiés de philosophes ne serait-ce qu’au dixième degré ? (…) Les Arabes ont substitué le terme de pensée à la philosophie ».
Sur un autre registre, le philosophe tunisien Fathi al-Miskînî refuse de qualifier « les lecteurs de la tradition » (Qurrâ’ at-Turâth) arabe et musulmane de « philosophes » quand bien même ils se présenteraient comme tel, car ils ont le défaut de penser l’identité arabe et musulmane actuelle.
C’est ce qu’il pense à propos de Mohammed ‘Abed al-Jabrî. Il écrit en effet à son propos qu’il « est sorti de la communauté des philosophes » et qu’il traite de « questions qui n’ont aucune relation avec la pensée philosophique » dans son ouvrage Le cogito blessé, la question de l’identité dans la philosophie contemporaine, 2013, pp. 205-2014.
A rebours de ce suivisme, des voix intellectuelles plus radicales dressent le constat en appelant à une philosophie qui naitrait de l’intérieur de la tradition arabe et musulmane. Bien plus, elles travaillent à forger un nouveau paradigme philosophique qui permet de penser le monde.
C’est le cas par exemple du philosophe soufi marocain Taha Abderrahmane (Question de méthode. Dans les horizons de la fondation d’un nouveau paradigme intellectuel, 2015), que le Nouveau Magazine Littéraire de janvier 2019 recense parmi « les 35 penseurs qui influencent le monde ».
Pour une philosophie spécifique aux sociétés arabes et musulmanes
Au commencement, le questionnement philosophique est d’abord et toujours socio-historiquement situé, il est, dès le départ, local en ayant une portée spécifique à un contexte, à une culture, à une religion, à une langue, à un patrimoine littéraire et à une tradition (qawmiyyatu al-falsafa ou khusûsiyyatu al-falsafa qui s’appuie sur ce qu’il appelle mabda’ attadâwul).
C’est à partir de ce postulat que T. Abderrahmane[1] rejette la primauté de la philosophie globale ou universelle, il conteste la préséance du caractère mondial de la philosophie (kawniyyatu al-falsafa) et sa portée ontologique en ce qu’elle serait d’emblée généralisable à tous les individus en tant qu’êtres existants.
La raison n’a aucun caractère absolu en ce qu’elle se passerait de tout guide extérieur, mais présente plutôt des limites et ne constitue pas cette substance qui nous distinguerait des animaux. T. Abderrahmane distingue trois degrés de rationalité : « al-‘aqlu al-mujarrad », « al-‘aqlu a-musaddad » et « al-‘aqlu al-mu’ayyad », qui correspondent à l’abstraction théorique limitée, déjà constatée par Kant, la pratique conforme à la législation divine et enfin la certitude spirituelle et soufie qui est le degré le plus élevé de la rationalité revisitée.
D’où la possibilité pour chaque Nation d’avoir sa propre philosophie, loin de toute hégémonie condescendante (Taha Abderrahmane, Le droit arabe à une philosophie propre, 2002)[2].
Dans un autre ouvrage où il promeut le droit des musulmans à bénéficier d’une différence d’ordre intellectuelle, il pose comme fil conducteur la question suivante que toute communauté doit se poser à sa façon : « Est-ce que la communauté musulmane possède une réponse propre aux questions de son temps ? » (T. Abderrahmane, Le droit des musulmans à une pensée propre, 2005).
Que l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’un repli sur soi idéologique ou un nationalisme philosophique, absolument pas selon T. Abderrahmane, mais d’une « complémentarité et d’un enrichissement » reconnus comme différence distinctive des philosophies propres des uns et des autres (T. Abderrahmane, Le débat comme horizon de la pensée, 2013, p. 15).
Cela étant précisé, T. Abderrahmane fait le constat amer et pour le moins très surprenant de la non existence d’une philosophie arabe et musulmane !
Pour lui, pour être philosophe, il faut être créatif et apporter des compréhensions innovantes, condition qui, à ses yeux, est loin d’être satisfaite, car en effet « l’acte de philosopher et l’imitation ne peuvent être réunis ensemble chez le philosophe », or « la philosophie arabe n’a jamais été créative » (T. Abderrahmane, Le débat comme horizon de la pensée, 2013, p.154).
Parmi les compréhensions créatives dont est friand T. Abderrahmane il y a sa propre définition analytique de la rationalité. Un thème récurrent et qui traverse toute son œuvre philosophique et spirituelle (Voir par exemple T. Abderrahmane, Le sens de la philosophie 1. La philosophie et la traduction, 1996 = Fiqh al-falsafa 1. Al-falsafa wa at-Tarjama).
D’abord, pour lui, la raison n’a aucun caractère absolu en ce qu’elle se passerait de tout guide extérieur, mais présente plutôt des limites et ne constitue pas cette substance qui nous distinguerait des animaux. Il voit dans la définition commune de raison une vision parcellaire (T. Abderrahmane, L’action religieuse et le renouvellement de la raison, 1989).

Il distingue trois degrés de rationalité : « al-‘aqlu al-mujarrad », « al-‘aqlu a-musaddad » et « al-‘aqlu al-mu’ayyad », qui correspondent respectivement à l’abstraction théorique limitée, déjà constatée pourtant par E. Kant, ensuite la pratique conforme à la législation divine et enfin la certitude spirituelle et soufie qui est le degré le plus élevé de la rationalité revisitée (Ghaydane Assayyid ‘Ali, La question de la philosophie propre. Les paris de la créativité dans la pensée arabe contemporaine, 2018. Chapitre 2 : Le droit à la philosophie propre chez Taha Abderrahmane, pp. 69-115).
Cette conception de la rationalité ne doit donc pas se distinguer de la morale (al-akhlâq aux sens comportemental et spirituel du terme) et doit prendre appui sur la législation divine et non pas l’inverse comme chez E. Kant. Ainsi, la philosophie véritable est celle qui allie raison et morale.
La morale occupe une place extrêmement importante dans l’œuvre de T. Abderrahmane au point qu’il propose de revoir la hiérarchie des finalités supérieures de l’islam (Al-Maqâcid) en donnant à la morale une place prépondérante et en l’intégrant comme source du droit musulman, ce qui est une première dans l’histoire de la pensée musulmane.
Pour une modernité spécifique aux sociétés arabes et musulmanes
Les lectures pseudo-modernistes des philosophes contemporains illustrent cette imitation aveugle de la philosophie et de la pensée occidentales et le rejet de la tradition. T. Abderrahmane dévoile ce qu’il appelle les « stratégies des lectures modernistes imitatrices » dans un autre ouvrage majeur (L’esprit de la modernité. Introduction à la fondation de la modernité musulmane, 2006, p. 178).
La première stratégie est « khuttatu at-Ta’nîss ou khuttatu al-anssina », la stratégie humanisante, elle consiste à lever le caractère sacré du Coran en lui donnant une caractéristique humaine. La deuxième est « khuttatu at-Ta’qîl ou khuttatu al-‘aqlana », la stratégie rationalisante, donnant la toute-puissance à la raison, (et occultant la dimension invisible de la Révélation), qui refuse les sciences du Coran, et applique aveuglément les méthodes des lectures chrétiennes et juives et des sciences humaines et sociales au Coran…
Et la troisième stratégie est « khuttatu at-ta’rîkh ou khuttatu al-arkhanah », la stratégie historicisante, qui rejette l’immuabilité du Coran en relativisant ses versets à leurs contextes socio-historiques.
Pour Taha Abderrahmane, ces penseurs arabes qui philosophent au nom de la modernité sont en réalité des imitateurs, au premier rang desquels Mohammed Arkoun, ‘Abdelmajid Charfi, Youssouf Siddiq, Nasr Hamid Abou Zayd, Tayyib Tizini (L’esprit de la modernité, 2006, p. 177).
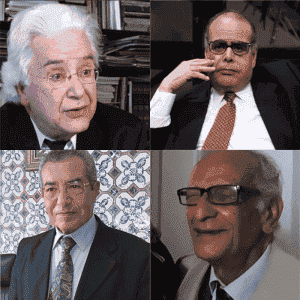
L’auteur a une toute autre conception de la modernité qui ne rompt pas avec la tradition. Il fait la différence entre d’une part la modernité positive (wâqi’u al-hadâthah), telle qu’elle est, et de l’autre l’esprit ou l’essence de la modernité (rûhu al-hadâthah).
Celle-ci est la puissance réalisatrice des valeurs et des principes qui sont facteurs de renaissance civilisationnelle quels que soient le lieu et l’époque. La modernité positive, réelle, telle qu’elle existe dans une époque et espace donnés, est la réalisation de ces valeurs et principes. Ce sont deux choses différentes.
Il semblerait que les sociétés arabes et musulmanes se soient focalisées sur les modernités positives, surtout la modernité occidentale, ignorant l’importance de l’essence de la modernité (rûhu al-hadâthah) qui leur permetrait d’entrer dans leur modernité propre.
T. Abderrahmane n’en finit pas de choquer en disant « certes, je ne vois pas de modernité arabe, les modernistes arabes sont franchement imitateurs, par exemple, quand apparaît la déconstruction, ils adhérent à la déconstruction, et quand le structuralisme apparaît, ils deviennent structuralistes, et ainsi de suite (…) Je ne condamne pas le fait de copier sur les autres, mais il faut le faire de façon créative et innovante » (Le débat comme horizon de la pensée, 2013, p.104-105).
L’ouvrage « L’esprit de la modernité » de T. Abderrahmane comporte une introduction et trois chapitres qui détaillent respectivement les trois principes indispensables pour réaliser l’esprit de la modernité.
Le premier est intitulé « mabda’ ar-rushd », qui consiste à ne laisser personne penser à sa place, un principe que ne respectent pas ceux qui adoptent la modernité positive occidentale. Le deuxième principe est « mabda’ an-naqd » qui représente l’esprit critique et la capacité à formuler des objections constructives à ce que l’on reçoit comme informations.
Le troisième principe est « mabda’ ash-shumûl » où la modernité a vocation à s’étendre à toutes les sociétés et à tous les domaines, principe qui n’est pas à confondre avec le totalitarisme, insiste T. Abderrahmane. Ces trois principes s’affranchissent des définitions dominantes de la modernité, comme le rationalisme, l’individualisme, la démocratie, la laïcité, etc.
La traduction créative et l’anti-Ibn Rushdisme assumé de Taha Abderrahmane
Pour avoir sa propre philosophie et sa modernité propre, T. Abderrahmane se penche en tant que philosophe du langage et logicien sur la question de la traduction. La traduction est un sujet récurrent dans son œuvre.
Pour lui, la majorité des traductions philosophiques arabes sont tombées dans l’imitation, non pas parce que les philosophes manquaient de liberté d’expression comme on peut le penser, mais par la superficialité et la raideur de leurs traductions et expressions littéraires.
La preuve en est que les soufis, malgré l’élitisme de leur pensée, ont réussi à influencer les gens du commun grâce à un usage très large des possibilités de la langue atteignant leurs esprits et leurs cœurs (T. Abderrahmane, Le débat comme horizon de la pensée, 2013, p. 70).
Ibn Rushd a offert aux européens sur un plateau la philosophie d’Aristote débarrassée de toute empreinte islamique, ce qui le rendit célèbre. Il est le premier a réalisé « la sécularisation du savoir » ou la « laïcisation du savoir » qui a profité aux Européens contre l’Eglise, puisqu’il a opéré une nette distinction entre d’une part le discours législatif et la sagesse philosophique d’autre part.
« La philosophie arabe ne présente pas de créativité ; et la cause de sa mort est la façon dont elle pratique la traduction, une façon muette qui ne parle pas (…) et aveugle qui ne voit pas (…) Car elle veut parler une langue étrangère en langue arabe, en fin de compte elle ne parle ni celle-ci ni celle-là (…) et la traduction de « Qu’est-ce que la philosophie ? » de Gilles Deleuze est une bonne illustration de la traduction muette et aveugle » (T. Abderrahmane, Débats pour le futur, 2000, éd. 2011, p. 105).
Mais alors, comment traduire ? T. Abderrahmane distingue trois degrés de traduction : la première est « at-Tarjama at-Tahsîliyya » qui est la traduction littéraliste et terminologique soucieuse de restituer tous les termes du texte original.
La deuxième est « at-Tarjama at-Tawsîliyya » qui demeure littéraliste mais seulement dans le contenu véhiculé, c’est-à-dire qui restitue fidèlement les significations en y ajoutant si nécessaire quelques termes.
La troisième est « at-Tarjama at-Ta’sîliyya » qui manipule librement le texte original que ce soit au niveau des termes ou des significations permettant au lecteur de philosopher. Et c’est bien cette dernière traduction qui permet l’existence de la philosophie, en l’occurrence arabe et musulmane (T. Abderrahmane, Le sens de la philosophie 1. La philosophie et la traduction, 1996).
En guise d’application de cette dernière modalité de traduction, il se livre dans ce dernier ouvrage durant près de 100 pages (de p.409 à p.506) à la traduction du « cogito cartésien ». Ainsi au lieu du « je pense donc je suis », « anâ ofakkir ithane fa anâ mawjûd », il propose longuement en arabe « onthor tajid », une traduction en phase avec la tradition musulmane et linguistique arabe.
La première catégorie de traduction ainsi que la deuxième ne permettent pas de philosopher, au mieux elles permettent la multiplication des commentaires pour lever l’ambiguïté des concepts et des significations complexes.
T. Abderrahmane cite comme exemple la célèbre anecdote de Ibn Sîna (Avicenne) qui raconte avoir lu 40 fois la métaphysique d’Aristote sans rien y comprendre, jusqu’à ce qu’il tombe enfin sur les commentaires de Farabi. Il dût même donner une aumône par reconnaissance envers cette révélation !
Pire, et c’est là une position singulière de T. Abderrahmane, Ibn Rushd (Averroès) est à ses yeux un « imitateur » qui a contribué à la sclérose de la philosophie arabe et musulmane. Il n’a ni innové dans la philosophie à travers le Fiqh, à l’instar de Shâtibî, ni innové dans les fondements du Fiqh à travers la logique, à l’instar de Al-Ghazâlî.

Ibn Rushd n’est parvenu qu’à la traduction tawsîliyya, c’est-à-dire transmissive en sacralisant le contenu des textes traduits, « c’est le plus grand des philosophes imitateurs », et ce y compris dans son ouvrage majeur « L’incohérence de l’incohérence » qui défend les philosophes imitateurs contre Al-Ghazâlî, selon T. Abderrahmane.
Pour lui, « Ibn Rushd est un philosophe occidental avec une langue arabe », et en citant Ibn Sab’îne, si Aristote avait dit que l’homme est à la fois assis et debout, Ibn Rushd aurait dit la même chose en dérogeant au principe de non contradiction.
Ibn Rushd a offert aux européens sur un plateau la philosophie d’Aristote débarrassée de toute empreinte islamique, ce qui le rendit célèbre. Bien plus, selon T. Abderrahmane, Ibn Rushd est le premier a réalisé « la sécularisation du savoir » ou la « laïcisation du savoir » qui a profité aux Européens contre l’Eglise, puisqu’il a opéré une nette distinction entre d’une part le discours législatif et la sagesse philosophique d’autre part.
Chez Ibn Rushd ce sont deux choses bien distinctes, notamment dans son « discours décisif » (Lire T. Abderrahmane, Le débat comme horizon de la pensée, 2013 et Débats pour le futur, 2000).
Mouhib Jaroui
Notes
[1] Taha Abderrahmane est un penseur musulman, plus précisément sunnite et soufi, né au Maroc, il a fait ses études universitaires en France où il a obtenu deux doctorats à la Sorbonne, dont l’un porte sur la philosophie du langage et le deuxième sur la logique. Il a enseigné à l’université Mohammed V de Rabat depuis 1970 et a produit une bonne dizaine d’ouvrages qui portent la même préoccupation : son projet consiste à fonder une philosophie qui prend ses racines islamiques dans le Coran, la Sunna et les savants de l’islam respectueux de la tradition islamique et arabe, dit-il de son cheminement intellectuel. Pour voir comment le soufisme fut pour lui la porte d’entrée dans la philosophie véritable, lire le chapitre 7 intitulé « Soufismes » du livre Débats pour le futur, 2000, p.p 135-146.
[2] Tous les titres d’ouvrages qui vont suivre sont en arabe, il s’agit de notre propre traduction.
A lire sur le même sujet :