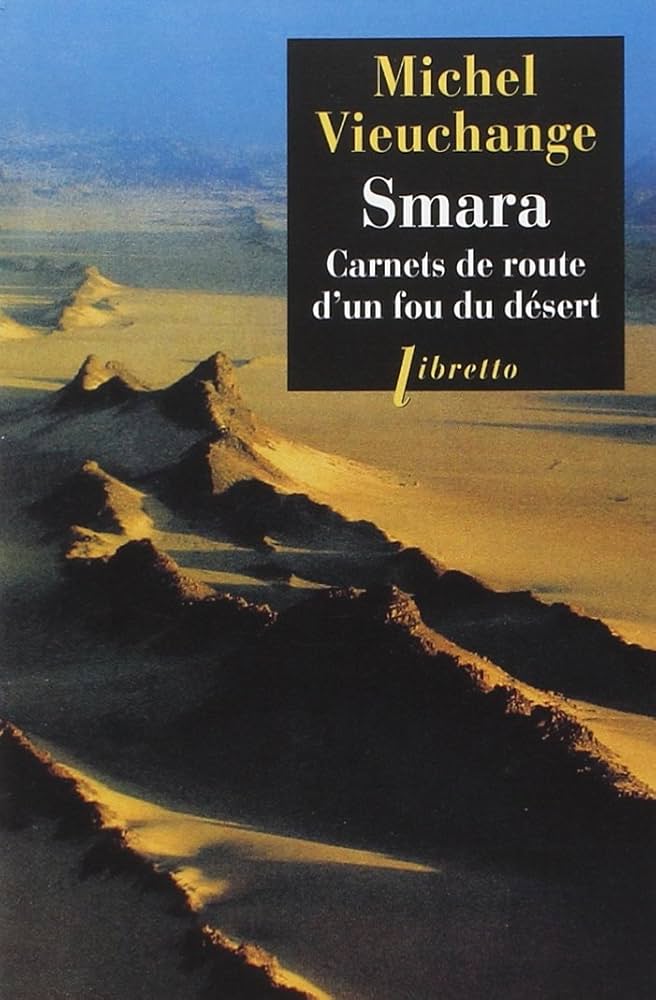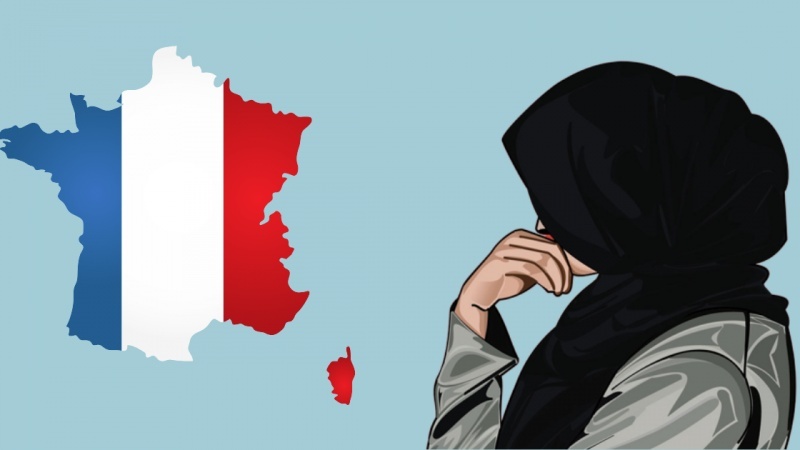La région du Sahara n’a pas toujours été désertique. Une étude génétique révèle qu’entre 12 500 et 3000 av. J.-C., le Sahara était verdoyant et habité par une population isolée aujourd’hui disparue. L’analyse du génome de deux femmes ayant vécu il y a plus de 6 000 ans apporte un nouvel éclairage sur cette civilisation oubliée. Zoom.
Entre 11 000 et 5 000 ans, durant la période africaine humide, le nord de l’Afrique était couvert de lacs et abritait une faune prospère. Dans ce « Sahara vert » vivaient les premiers bergers africains. Pour la première fois, un génome datant de cette époque a pu être déchiffré.
Deux ADN analysés
Entre 12 500 et 3000 av. J.-C., cette région « était méconnaissable, transformée en une savane luxuriante pendant une période anormalement humide, l’African Humid Period [appelée aussi Sahara vert] », rappelle Nature. Cependant, les conditions extrêmes du désert actuel ont rendu difficile la préservation d’ADN ancien, limitant notre compréhension de ces populations.
Pour la première fois, grâce à des fouilles menées sur le site de Takarkori dans les montagnes du Tadrart Acacus, en Libye, des archéologues ont découvert les restes d’une quinzaine de femmes et d’enfants. Deux d’entre eux, des femmes âgées d’environ quarante ans et ayant vécu il y a plus de 6 000 ans, ont livré un ADN exploitable.
Leur analyse, qui fait l’objet d’un article scientifique paru dans Nature, révèle que cette population était isolée des autres groupes humains d’Afrique.

Une lignée nord-africaine isolée et distincte
L’analyse génétique révèle que cette population formait une lignée distincte et isolée, aujourd’hui disparue. Contrairement aux hypothèses précédentes, cette lignée nord-africaine ne présentait aucun marqueur génétique subsaharien ancien, mais semblait être issue des populations locales du Maghreb.
Les chercheurs ont établi un lien avec des chasseurs-cueilleurs ayant vécu 15 000 ans plus tôt dans la grotte de Taforalt, au Maroc. Ces résultats indiquent que, malgré son environnement propice, le Sahara vert n’a pas servi de corridor migratoire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.
« On est restés perplexes devant ces résultats. Comment se fait-il que cette lignée ne se soit pas étendue vers l’est, vers l’ouest ou vers le sud ? », s’interroge Nada Salem, paléogénéticienne à l’institut Max-Planck. Savino Di Lernia, responsable des fouilles à Takarkori, en conclut que « le Sahara vert n’a pas été un corridor pour les humains, mais il l’a été pour les idées et les technologies ».
A lire également :