Que se passe-t-il quand, au Danemark, un prénom comme Mohammed devient une donnée, une variable, un signal faible dans une équation censée mesurer le QI ? Derrière les chiffres et les corrélations, c’est une cartographie implicite des identités qui se dessine, et avec elle, une hiérarchie silencieuse. La dernière chronique de Faouzia Zebdi-Ghorab à lire sur Mizane.info.
Au Danemark, une étude menée par E.W. Kirkegaard et T.L. Madsen a croisé les scores aux tests cognitifs de l’armée danoise, avec les prénoms des conscrits. Cette recherche visait à traquer d’éventuelles corrélations entre prénom, intelligence supposée et statut social. Les données couvrent la période 2005-2015. Résultat ? Des écarts nets de QI selon les prénoms. Et surtout, une tendance lourde. Les prénoms d’origine maghrébine comme Mohammed, Ahmed, Mehmet ou Ahmad sont associés aux scores les plus bas.
L’un des objectifs de cette étude était dit-on, de sonder les déterminismes sociaux. Mais en réalité, elle mettait le doigt sur une fracture beaucoup plus vaste : celle de la représentation.
Le prénom Mohammed, soupçon statistique au Danemark
Cette étude laisse émerger les déclinaisons d’un seul et même nom, celui d’une figure sacrée, colonne de l’identité musulmane. L’équivalent du Christ pour le monde chrétien. Imaginerait-on une étude « démontrant » que les Christian, Christophe, Christiaan ou Christine sont surreprésentés dans la délinquance ?
Un prénom, c’est plus qu’un mot. C’est un code social, une empreinte culturelle, un révélateur de trajectoires. En l’analysant, on ne lit pas l’individu, mais une histoire de capital, économique, éducatif, et symbolique. Et les écarts de performances cognitives reflètent, souvent, l’écart d’accès à ces ressources.
Mais lorsque certains prénoms se retrouvent systématiquement en bas du tableau, il faut s’interroger sur le test. Mesure-t-il vraiment l’intelligence ou la capacité à correspondre à une norme culturelle implicite ? Frantz Fanon avait déjà pointé du doigt cette question à propos de ses patients d’origine afro-maghrébine[1].
. En effet, un questionnaire, une grille d’évaluation, un entretien, tout cela induit une vision du monde. Dans le cas d’un individu plus habile par exemple, à la récitation des 6326 versets du Coran qu’à la lecture de Proust, que mesurerait-on vraiment ? Le QI, ou l’écart culturel et référentiel ?
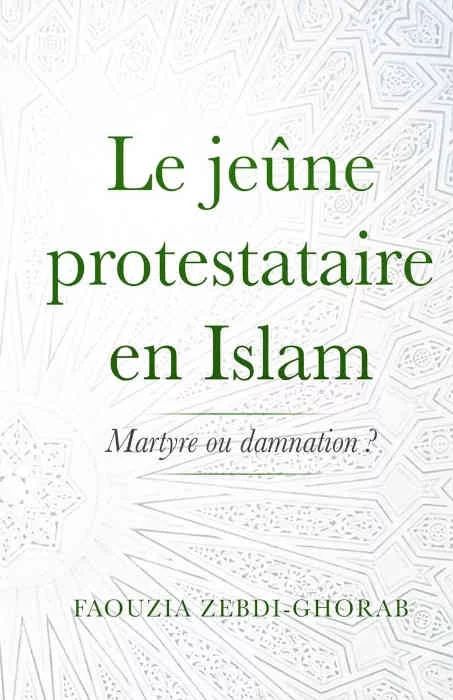
Par ailleurs, il faut considérer la perception sociale. Le prénom oriente indéniablement la perception. Il colore l’attente. Dans une salle de classe ou sur un CV, il parle avant même que l’élève ou le candidat n’ouvre la bouche. Ainsi cette étude, sous prétexte de neutralité, pourrait bien révéler ce que la société croit déjà savoir ou plutôt ce qu’elle veut croire.
QI, prénom et illusion de représentativité
Le Danemark, comme d’autres pays européens est traversé par une ligne de fracture symbolique entre les prénoms « de souche » et les autres. Dés lors, en cartographiant des écarts cognitifs selon cette ligne, on risque moins de comprendre les inégalités que de les graver dans l’esprit collectif.
On oublie souvent qu’un prénom agit comme un passeport social ou une frontière. Il précède l’individu, conditionne les attentes, oriente les regards. À l’école, à l’embauche, à l’hôpital, il chuchote à l’oreille des institutions ce que le porteur n’a pas encore dit. De ce fait, cette étude qui prétend interroger des corrélations risque, en réalité, de conforter des anticipations. Et de transformer le soupçon social en prédiction pseudo-scientifique.
Mais que vaut cette « objectivité » quand l’échantillon lui-même est biaisé ? Les données, issues de cette étude publiée sur ResearchGate sont tirées de l’armée danoise. Or l’armée sélectionne, trie, et filtre. Seuls les jeunes hommes physiquement et cognitivement aptes, y accèdent. Ceux qui échouent n’y figurent pas. Autrement dit, on ne mesure pas la société, mais une tranche déjà triée, déjà nivelée.
Un échantillon militaire exclut aussi bien les parcours d’excellence que les marges sociales. Ni les diplômés des grandes écoles ni les exclus du système ne font partie des sondés. En outre, dans certains cas, l’armée attire ceux pour qui les voies classiques se sont fermées. C’est souvent un choix par défaut, un recours plus qu’un projet. Par ailleurs, de nombreuses études — notamment aux États-Unis — montrent que les nouvelles recrues viennent souvent d’une population en difficulté d’insertion, tant dans le secteur privé que public, qui s’engage en dernier recours pour accéder, via l’armée, à des formations et autres apprentissages.
Publier sur le QI et les prénoms : science ou signal ?
Alors, pourquoi rendre publique une telle « étude » ? N’aurait-elle pas dû rester circonscrite au monde scientifique ? Officiellement, c’est pour mieux comprendre les inégalités éducatives. En réalité, une étude qui associe prénoms et QI ne s’offre pas au débat scientifique. Elle s’expose plutôt à l’instrumentalisation médiatique. Elle devient une munition dans la guerre des perceptions.
Là où certains y verront un appel à corriger les injustices, d’autres y liront une confirmation. La confirmation que certains prénoms « tirent vers le bas », que certaines origines « posent problème ». Et l’effet domino commence : l’école ajuste ses attentes, l’employeur anticipe les écarts, et le recruteur filtre sans même s’en rendre compte.
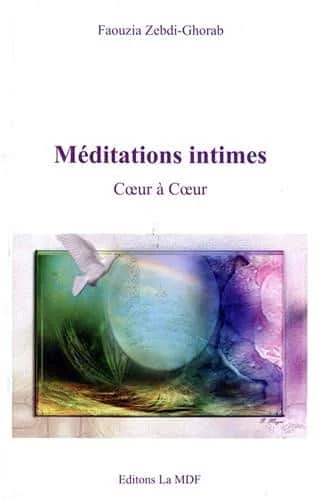
C’est ici que se joue le piège ultime de la prophétie autoréalisatrice. Plus on répète que tel prénom est lié à une faiblesse cognitive, plus les porteurs de ce prénom se verront assignés à l’échec, socialement, scolairement, et psychologiquement. Et lorsque l’échec survient, il confirme ce que l’étude prétendait seulement observer. Et la boucle est bouclée.
Du prénom à l’assignation : quand le QI enferme
En dehors des laboratoires, une étude comme celle-ci agit comme une nappe de brouillard : elle trouble les repères, légitime les soupçons, ancre les stéréotypes. Plutôt que de questionner les inégalités structurelles — l’école, le logement, l’emploi — on essentialise. On transforme des prénoms en diagnostics sociaux.
Or une étude honnête aurait dû aller plus loin. Elle aurait dû montrer que les corrélations disparaissent dès qu’on change de cadre. Dans les grandes écoles, dans les entreprises exigeantes, dans les environnements où l’accès à l’excellence est garanti, l’ombre portée du prénom s’efface. Là, ce n’est plus le prénom qui parle, mais le parcours.
Elle aurait aussi pu rappeler que les prénoms n’ont pas de destin. Ils changent, glissent, se transforment. Ce qui était perçu comme « populaire » hier peut devenir prestigieux demain. Il suffit qu’un sportif, qu’un artiste ou un écrivain en incarne la grandeur. L’histoire regorge d’exemples où un nom autrefois connoté « banlieue » ou « immigration » s’est transformée en emblème de réussite ou de fierté nationale.
Si l’étude s’était arrêtée sur ces observations plus larges, elle aurait permis d’éviter les interprétations biaisées érigées en vérités statistiques. Elle n’a pas pris soin de poser ses limites. Pas un mot sur le fait que corrélation ne vaut pas causalité. Rien non plus pour rappeler que ce que vous voyez là est contextuel, non universel. Et surtout, aucun avertissement : un prénom n’est pas une sentence.
En l’état, sans ces précisions, le test présente un fort risque de mauvaise interprétation et d’utilisation biaisée, ce qui le rend plus problématique que réellement utile sur le plan sociologique.
Une éthique de la responsabilité
L’étude aurait dû préciser que les corrélations sont contextuelles et non universelles. Elle aurait dû montrer que ces écarts disparaissent avec l’accès à l’éducation et aux opportunités. Elle aurait dû ne pas laisser place à une interprétation déterministe, matrice implicite de l’essentialisme social.
Si une étude prétendait démontrer un lien entre certains prénoms et le suicide, on aurait hurlé –à juste titre– au danger. L’effet serait similaire à ce que l’on a observé avec le phénomène Werther, ou « suicide contagion », où la médiatisation excessive d’un suicide entraîne une augmentation des passages à l’acte dans la population.
Dans le cas de l’étude danoise, le risque est certes moins menaçant, mais le mécanisme reste le même. Elle associe un prénom –donnée personnelle inaltérable– à une caractéristique perçue comme objective et hiérarchisante : le QI.
Associer un prénom, inaltérable, hérité, et intime, à une note de QI, c’est introduire une hiérarchie là où il devrait n’y avoir que des trajectoires. C’est figer ce qui devrait rester ouvert. C’est discriminer sous couvert de mesurer.
Quand mesurer le QI, c’est aussi marquer
La recherche ne peut pas tout dire, tout publier, tout quantifier, sans se demander : à quoi cela servira-t-il ? Qui s’en emparera ? Qui en fera une arme ? Car ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement l’intelligence, mais la dignité d’individus déjà stigmatisés, et assignées à résidence dans l’imaginaire social.
Faouzia Zebdi-Ghorab
[1] Fanon montre notamment que les grilles d’analyse psychiatriques occidentales, prétendument objectives, sont en réalité traversées par des présupposés culturels eurocentrés, qui pathologisent ce qui ne correspond pas à leurs normes implicites. Ses travaux ont contribué à ouvrir la voie à une psychiatrie transculturelle, attentive à la manière dont les traumatismes collectifs, les rapports de pouvoir postcoloniaux et les références culturelles structurent la psyché et, par conséquent, la manière même dont elle est « mesurée.










