Un an après la création de la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites CIVS, une loi-cadre fait toujours défaut pour permettre la restitution des œuvres spoliées dans les anciennes colonies françaises. Les pays africains restent dans l’attente malgré l’engagement pris par Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017. Focus.
La question des restitutions d’œuvres spoliées dans les anciennes colonies françaises semble aujourd’hui mise de côté. Bien qu’un projet de loi ait été rédigé en 2023 sous l’impulsion de l’ex-ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, il a été suspendu à la suite d’un avis du Conseil d’État pointant un vice juridique. Sa successeure, Rachida Dati, n’a pas relancé le dossier. Les dirigeants africains peuvent donc toujours attendre.
Les promesses non tenues d’Emmanuel Macron
Le 9 avril dernier, la restitution du djidji ayôkwé – un tambour cérémoniel de 430 kg saisi par l’armée française en 1916 – a été examinée en commission au Sénat, avec un vote prévu le 28 avril. Cet objet devrait faire l’objet d’une loi spécifique, en l’absence d’un cadre général. L’avocat Pierre Noual commente cette absence juridique :
« L’histoire de ce tambour – œuvre d’art et outil de résistance – montre qu’on essaie de faire des gestes mais sans passer par une voie officielle, claire et précise comme c’est le cas pour les spoliations nazies ou les restes humains étrangers. »
Il a fallu attendre six ans pour que la Côte d’Ivoire obtient enfin la restitution du djidji ayôkwé. Une législation générale, pourtant annoncée, n’est aujourd’hui plus d’actualité. Pourtant, dès 2017, Emmanuel Macron s’était engagé, à Ouagadougou, à ce que « les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique » dans un délai de cinq ans.
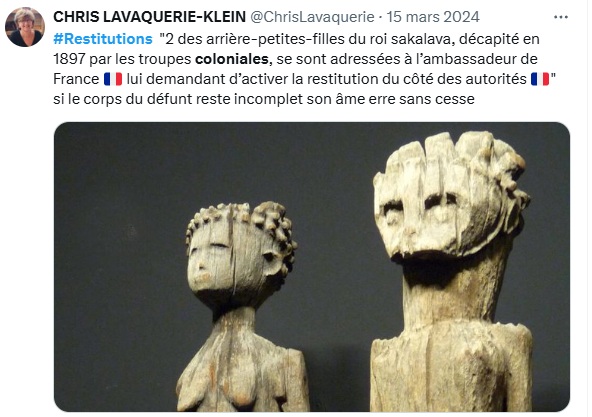
Un processus juridique long et complexe
À la suite de l’engagement présidentiel, un rapport publié en 2018 par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr révélait que 85 à 90 % du patrimoine africain se trouve en dehors du continent. Le musée du Quai Branly est particulièrement concerné : sur 70 000 œuvres, environ les deux tiers auraient été acquis entre 1885 et 1960.
Or, la restitution de chaque œuvre nécessite un processus juridique long et complexe. Si des lois spécifiques ont été adoptées, comme celle du 24 décembre 2020 permettant la restitution de 26 pièces au Bénin et d’un sabre au Sénégal, un cadre global juridique clair reste volontairement absente.
A lire sur le sujet : Algérie : Quels sont les biens historiques réclamés à la France ?
Des réserves infondées
Pour Pierre Noual, « ces réserves, qui peuvent parfois flirter avec le nationalisme, sont dangereuses dans une époque où la démagogie politique est de plus en plus problématique (…). Il faut éviter tout paternalisme sur la question de la mémoire et de la culture ».
Malgré les promesses d’Emmanuel Macron, « le chemin sera sans doute long pour que la France accepte de se séparer d’un patrimoine indûment constitué. »









