Dans un article universitaire, en trois parties, consacré aux systèmes éducatifs et à l’enseignement sous les différentes dynasties politiques de l’Andalousie musulmane, Rachid el Hour nous éclaire sur le rôle du pouvoir et les conditions sociales de l’éducation musulmane au en Andalousie et au Maghreb.
Le système d’éducation et d’enseignement reflète l’idéologie des États, voire celle de leurs systèmes politiques et religieux. Les Almohades ne font pas exception à cet égard, car ils accordent une grande attention à cet aspect, en particulier sous la direction du fondateur du mouvement, qui utilise sa position d’enseignant et d’intellectuel pour créer une armée d’intellectuels et de disciples, qui géreront plus tard toutes les affaires de l’État. Ibn Tūmart est pleinement conscient de l’importance cruciale de l’éducation dans la diffusion de la propagande de son idéologie, mais plus important encore, ses idées attirent de nombreux adeptes qui assureront le succès du mouvement et, par conséquent, la viabilité d’un empire qui durera un temps considérable, surtout si on le compare à ses prédécesseurs almoravides.
Après la mort d’Ibn Tūmart en 524/1130, le calife ‘Abd al-Mu’min prend la tête de l’État almohade, « certes pas en tant que Mahdi, mais en tant que chef du mouvement politique qui en résulte. ‘Abd al-Mu’min se chargea de réorganiser la structure politique et suivit les plans établis par le chef du mouvement, accordant une grande importance et priorité au système éducatif et à l’enseignement, qui étaient considérés comme des outils fondamentaux pour la construction idéologique du nouvel État. En avant-première, il convient de noter que l’ouvrage Al-Tawḥīd d’al-Mahdī Ibn Tūmart, le texte fondateur de la doctrine almohade, était enseigné à la fois en arabe et en berbère dans les mosquées andalouses.
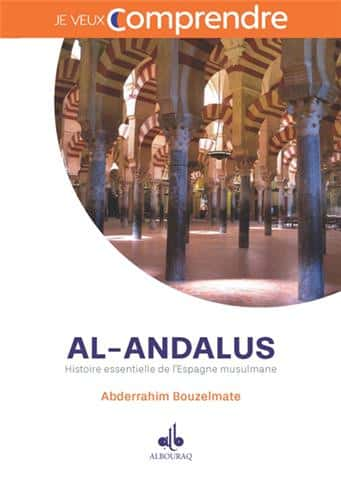
Les Almohades confièrent la tâche d’apprendre, de préserver et d’enseigner la doctrine au groupe de fonctionnaires le plus important de l’empire, les ḥuffāẓ , qui bénéficièrent de nombreux privilèges » ( Viguera 1992, p. 240 ). Aux périodes mérinide et naṣride, la situation changea, principalement en raison de l’introduction des écoles publiques ( El Hour 2019 ). Les cas étudiés d’Abū Ya`zā, d’al-Mājarī et d’al-Yuḥānisī nous permettent de voir non seulement les changements dans le processus de formation éducative et intellectuelle en al-Andalus et au Maghreb, mais aussi l’identité religieuse de chaque modèle éducatif.
Aperçu historique de l’éducation au Maghreb et en Andalousie
Plusieurs sources maghrébines abordent le thème de l’enseignement et de l’éducation, témoignant, entre autres, d’une préoccupation importante pour cet aspect. Parmi ces sources figure l’ouvrage d’Ibn Saḥnūn, intitulé Kitāb adāb al-mu’allimīn ( Ibn Saḥnūn 1972 ), considéré comme l’une des premières sources abordant cette question. Il y a ensuite l’ouvrage d’al-Qābisī, Al-Risāla al-mufaṣṣala fi aḥwāl al-mu’allimīn wa-l-muta’allimīn , auquel je reviendrai plus loin, et l’ouvrage d’al-Magrāwī intitulé Jāmi’ jawāmi’ al-ikhtiṣār ( Al-Maghrāwī s.d. ), sans parler de la Risāla d’Ibn Ḥabīb (m. 238/852), adressée au maître de son fils, qui est mentionnée par le susdit al-Mghrāwī. À ces ouvrages s’ajoutent d’autres qui comportent de nombreuses références à l’enseignement et à l’éducation, comme le Madkhal ( Ibn al-Hājj sd ) d’Ibn al-Hājj (m. 737/) ou le Kitāb al-siyāsa aw al-ishāra fi tadhbīr al-imāra ( Al-Ḥaḍramī 2003 ) d’Abū Bakr al-Ḥaḍramī (m. 489/).
À cela s’ajoute le rôle des soufis dans l’enseignement et l’éducation gratuite à travers leurs cours et leurs écrits. Nous ne nous étendrons pas sur l’importance de l’enseignement soufi, qui a été crucial dans l’islamisation du Maghreb et la consolidation de l’islam dans ce pays, en partie en raison de la proximité des soufis avec la population et de leur focalisation sur les enseignements de base, éloignés des complexités du fiqh .
Al-Risāla al-mufaṣṣala fi aḥwāl al-mu’allimīn wa-l-muta’allimīn d’al-Qābisī est l’une des sources les plus importantes traitant de l’enseignement et de l’éducation en Occident musulman. Il s’agit d’une sorte de traité ou d’ouvrage épistolaire sur les enseignants et les disciples. Cet ouvrage tunisien du Xe siècle montre clairement que l’éducation ne relevait pas de la compétence des gouvernements, et il n’existe aucune preuve que les dirigeants musulmans nommaient des enseignants ou leur versaient un salaire. Au contraire, l’éducation des enfants ou des personnes placées sous leur responsabilité était assurée par les parents et les tuteurs des élèves.

Certains gestes politiques, comme l’envoi par le calife `Umar b. `Abd al-‘Azīz d’un groupe d’enseignants orientaux au Maghreb pour enseigner l’islam aux Nord-Africains, ou l’invitation du calife almohade ‘Abd al-Mu’min à un groupe d’enseignants andalous en Afrique du Nord, n’impliquent pas une intervention officielle dans l’éducation ( Askān 2006, p. 16 ). Ibn Saḥnūn, pour sa part, discute des salaires des enseignants et de tout ce qui concerne les cours et les enfants, en faisant reposer entièrement la responsabilité financière de ces cours sur les parents des élèves (Ibn Saḥnūn 1972, p. 119).
Il existe de nombreux témoignages sur la responsabilité des parents dans le financement de l’éducation de leurs enfants, tant en Occident qu’à l’extérieur de l’Islam. Il s’agit en premier lieu des parents qui ont les moyens financiers, en plus de l’élite dirigeante. Nous nous limiterons à citer quelques exemples de tels parents. Les sources donnent des données sur les cas où les parents ont accompagné leurs enfants pour étudier soit en Occident, soit hors de l’Islam, en raison de la charge financière importante que représentait l’éducation ; en revanche, ceux qui n’avaient pas de ressources attendaient l’arrivée de grands maîtres au Maghreb, comme un certain Abū l-Ḥajjāj b. Namawī (m. 614/1218).
Les sources consultées fournissent divers exemples qui attestent du coût élevé de l’éducation. Notamment, Ibn Farḥūn (sd, p. 357) mentionne un individu nommé Abū `Umar Yūsuf al-Magāmī al-Andalusī, qui a dépensé plus de deux mille dinars lors d’un séjour de onze ans en Orient et est revenu endetté. D’autres étudiants, comme al-Bāǧī (mort en 476/) ( Ibn Farḥūn ( sd ), p. 120), devaient travailler pour financer leurs études. Certains se livraient au commerce ou voyageaient avec des membres de leur famille pour couvrir leurs dépenses, comme Muhammad b. Imran al-Mazdaghī (mort en 653/1256), qui se rendit en al-Andalus accompagné de son père, un marchand ( Al-Wazzān 1983, p. 261 ).
Étudier dans l’Occident musulman était loin d’être facile, surtout pour la population qui, au mieux, ne pouvait se permettre de payer l’éducation élémentaire – comme les écoles coraniques – qu’en nature ou comptait sur l’espoir qu’un professeur donnerait des cours gratuits, comme ce fut le cas d’Abū l-‘Abbās al-Sabtī. Je n’insisterai pas sur le fait que l’éducation médiévale était élitiste, en particulier au Maghreb, du moins jusqu’à l’arrivée des Mérinides.
À l’époque almohade, le paiement des salaires des enseignants ne se limitait pas à l’enseignement primaire, celui des écoles coraniques, mais incluait également l’enseignement supérieur. On rapporte que certains enseignants étaient rémunérés pour leurs cours, comme Muhammad b. al-Khaḍb (m. 583/1188), qui vivait à Fès et était strict quant à la rémunération de ses cours. Ibn `Abd al-Malik al-Marrākushī rapporte que ce professeur était impliqué dans des histoires extraordinaires liées à cette affaire ( Al-Marrākushī 1984, p. 649 ). L’attitude de ce professeur ressemblait à celle d’un certain Alī Muḥammad b. Kharūf al-Ḥaḍramī (m. 609/1213), qui faisait du commerce entre al-Andalus, Ceuta, Fès et Marrakech.
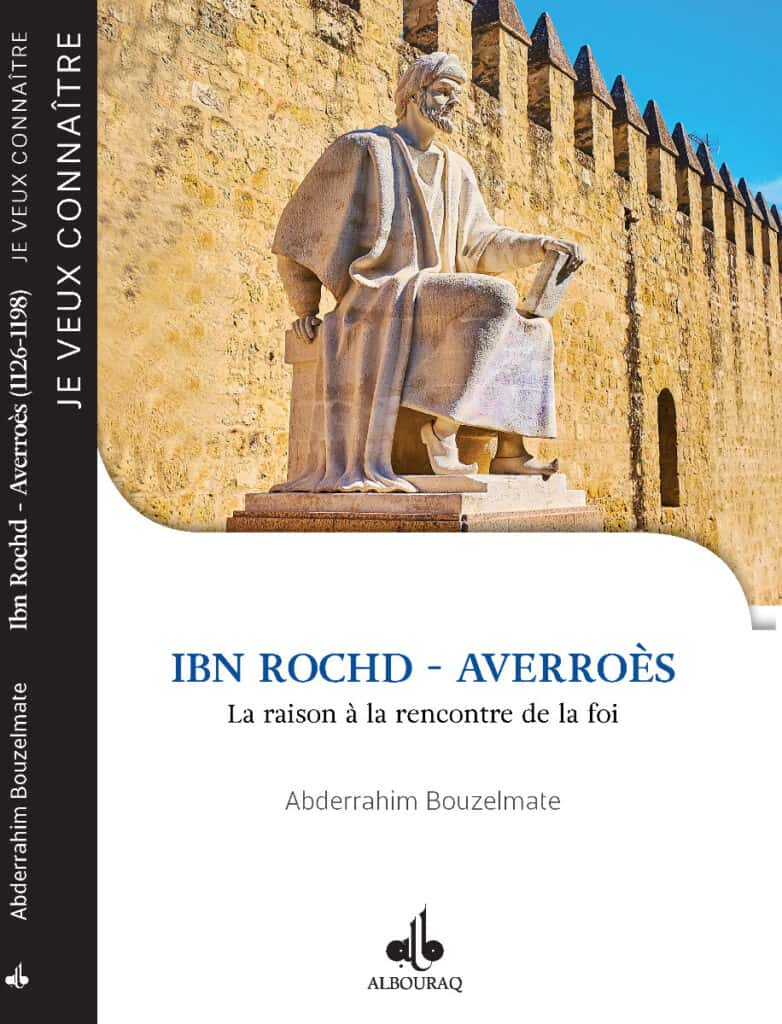
Il se consacra à l’enseignement dans tous les endroits qu’il visitait et ne dispensait personne de payer ses leçons ( Al-Marrākushī 1984, pp. 319-323 ) ; il ne faisait aucune distinction entre les étudiants riches et les plus pauvres, contrairement à la plupart des enseignants, comme Abū l-Abbās b. al-Arīf al-Sabtī (mort en 601/1205), qui enseignait la grammaire et l’arithmétique à Marrakech, faisait payer ses cours et dépensait ses revenus pour les étudiants les plus pauvres, comme l’a noté Aḥmad Bābā Al-Timbuktī ( sd, p. 16 ; Al-Tādilī 1984, p. 455 ).
Des sources arabes indiquent que, grâce à leur enseignement, certains enseignants ont accumulé des richesses considérables, comme en témoignent divers exemples. Muhammad al-Asqar a amassé plus de 700 dinars en trois ans grâce à ses cours de Coran ( Ibn al-Qāḍī 1972-1973, p. 216 ). Abū `Umr al-Shalubīn (562-645/1167-1248) a enseigné le fiqh pendant plus de 60 ans et a ainsi accumulé une grande richesse. Chaque étudiant payait 400 dirhams par mois ( Al-Marrākushī 1984, pp. 562-63 ) ; il en était de même pour `Alī b. Yūsuf al-Anṣārī (mort en 619/1223).
A al-Andalus, on trouve plusieurs exemples de la période almohade. Parmi les personnalités notables, on peut citer le Cordouan `Alī b. Muḥammad al-Fahmī, qui était le professeur des filles du calife al-Manṣūr et parvenait à percevoir 500 dirhams par jour. De ce fait, il a accumulé une richesse et des biens considérables, comme le souligne Ibn `Abd al-Malik ( Marín 2000, pp. 650-52 ). Les Almohades ont également embauché des enseignantes comme Ḥafṣa bint al-Ḥājj al-Rakūniyya (morte en 586/1190), qui enseignait aux femmes à la cour de Ya`qūb al-Manṣūr. L’éducation incluait également les domestiques et les esclaves de la cour.
Il est clair que les sources mettent principalement l’accent sur l’éducation de l’élite ; à l’inverse, les élèves les plus pauvres apparaissent dans les sources principalement en raison de la notoriété de l’enseignant. Certaines sources mettent en garde contre le traitement équitable entre les élèves riches et pauvres (Ibn Saḥnūn 1972, p. 83). Ce fait en soi peut nous aider à déduire les obstacles importants auxquels les pauvres ont été confrontés dans leur éducation.
Quelques exemples d’éducation des femmes
Je tiens à préciser que je n’ai pas l’intention de faire une analyse de genre, mais simplement de proposer quelques idées sur l’enseignement de « certaines » femmes de l’élite. Il ne s’agit pas de faire une analyse structurelle de l’éducation des femmes dans l’Occident islamique ; le Dr Manuela Marín s’en est occupée dans son excellent livre, Las mujeres en al-Andalus, Madrid, CSIC, 1999.
Je voudrais souligner que, bien que les fuqahā’ préfèrent éduquer les femmes parce qu’elles ont droit aux mêmes droits à l’éducation que les hommes, certains désapprouvent qu’elles apprennent les mêmes matières, en particulier l’écriture, car ils estiment que cela pourrait nuire à leur bien-être (Al-Qābisī 1986, p. 292). Pour cette raison, leur éducation est limitée par rapport à celle des hommes.
L’éducation des femmes concernait des individus de différentes classes, mais je me concentrerai sur les deux suivantes : celles des familles dirigeantes et celles des familles érudites (Ibn Saḥnūn 1972, p. 37) de milieu urbain, comme l’a noté Ḥusayn Askān ( 2006, p. 36 ). Je trouve la classification de l’auteur assez intéressante. Dans le cas de la première classe, certaines filles de gouverneurs, selon leur position dans la hiérarchie de l’autorité, étaient connues pour leurs vastes connaissances, en particulier les filles des familles dirigeantes.
Certaines filles de ces familles atteignaient un statut important dans le monde du savoir, devenant des femmes érudites ou ‘alimas dans des matières telles que la littérature, comme Zaynab, la fille du calife Ya`qūb al-Manṣūr, qui excellait également en théologie ou ‘ilm al-kalām ( Askān 2006, p. 36 ). Cependant, les femmes qui bénéficiaient le plus de l’éducation étaient celles de la période précédente, à savoir les femmes almoravides. L’accès à l’éducation leur permettait d’atteindre un statut social élevé, dépassant dans certains cas celui des hommes. Il convient de prêter attention au témoignage d’al-Ḥasan al-Wazzān ( Al-Wazzān 1983, p. 116 ), qui rapporte que dans la ville Ṣanhājī de Tassit, les femmes étaient celles qui apprenaient et qui exerçaient la fonction d’enseignantes dans les écoles de garçons et de filles.
Quant à la deuxième catégorie, celle des femmes issues des familles urbaines, des efforts furent faits pour que ces femmes apprennent toutes les sciences étudiées par les hommes. Par exemple, la fille du fondateur de la première école de Ceuta, Abū l-Ḥasan al-Shārī (mort en 649/1252), reçut des cours de hadith de son père et devint experte dans sa transmission. Les femmes jouèrent un rôle crucial dans l’enseignement des enfants, notamment dans les matières de base comme le Coran et le hadith, entre autres.
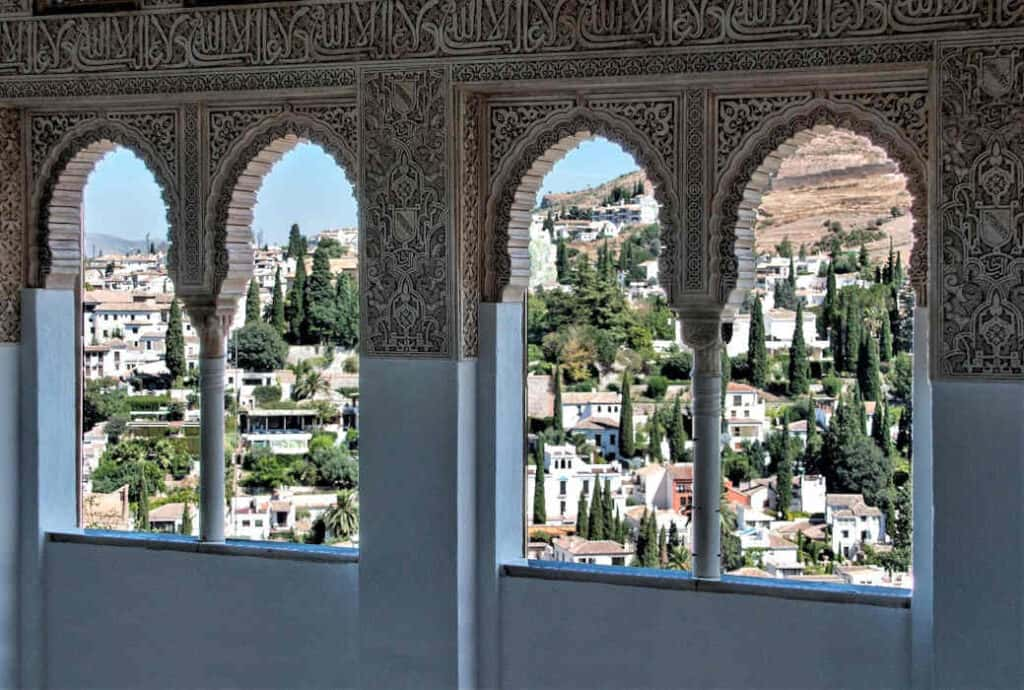
Nous avons des traces d’un nombre significatif de femmes érudites, tant au Maghreb qu’en al-Andalus. La grande majorité d’entre elles, comme l’affirme M. Marín (Marín 2000, p. 651), « ont acquis leur savoir par le biais de liens familiaux ; leurs maîtres étaient, en même temps, leurs pères, leurs frères ou leurs maris. On trouve des références à des femmes qui enseignaient à d’autres femmes ou à la présence, dans les palais royaux, d’enseignantes qui éduquaient les filles des princes.
Sayyida bint `Abd al-Ghanī (morte en 647/1249), une experte du Coran dotée d’une excellente calligraphie, a consacré toute sa vie à ce travail, et a été remplacée par ses deux filles lorsque cela était nécessaire. Les deux types d’éducation – enseignement par l’intermédiaire de parents maḥram ou par des femmes érudites – confirment la tendance à la séparation des sexes dans la diffusion du savoir » (Marín 2000, p. 651). Cependant, d’autres informations suggèrent que cette ségrégation était relative, même si la séparation entre étudiants et étudiantes restait taboue, comme le conseillent toutes les sources arabes qui ont abordé le sujet.
Lorsque l’on évoque l’éducation des femmes dans l’Occident musulman, plusieurs noms d’enseignants notables émergent, comme le sévillan Muḥammad b. Abī Bakr al-Azdī Ibn al-Fakhkhār (mort en 640/1242-1243), qui était décrit comme « un expert en ‘ilm al-kalām et dévoué à l’enseignement ». Sa biographie indique que « Dieu a permis à de nombreuses personnes, hommes et femmes, de bénéficier de lui (dans l’enseignement) jusqu’à sa mort à un âge avancé » ( Marín 2000, p. 651 ), ainsi que Muḥammad b. Aḥmad b. Abī l-Qāsim al-Anṣārī ( Marín 2000, p. 651 ), un ascète de Jerez qui s’est concentré sur l’éducation des femmes ( ta’dīb al-nisā’ ).
Pour conclure cette section, il convient de mentionner le récit d’Ibn Abd al-Malik sur le Cordouan Alī b. Muḥammad b. Yūsuf b. `Abd Allāh al-Fahmī (mort en 618/1221–2), dont la biographie reflète l’importance de la vertu comme condition fondamentale de l’enseignement des femmes, en particulier des femmes de la cour, comme dans le cas présent. Prêtons attention à ce que nous dit l’auteur du Dayl.
Ibn `Abd al-Malik nous informe que « al-Fahmī résidait à Salé puis à Marrakech […] Il avait mémorisé le Coran, était un expert dans les lectures coraniques et possédait une voix remarquablement belle qui était un miracle de Dieu […] Un jour, le calife almohade al-Manṣūr passa à côté de lui alors qu’il récitait, comme à son habitude, le Coran dans un cimetière, et il fut captivé par l’excellence de son chant et la bonté de son dessein. Il le fit amener devant lui, l’incorpora à son service et lui ordonna d’enseigner à ses enfants et de réciter le Coran pendant le Ramadan […] Après avoir appris sa chasteté et sa vertu, il lui ordonna d’enseigner également à ses filles. Il refusa, citant qu’il considérait qu’il était approprié de maintenir une certaine séparation entre les sexes. Cela le rendit encore plus cher au calife, car cela démontrait la sincérité de ses intentions ; il fut alors contraint de leur enseigner (aux filles) » (Marín 2000, p. 652 ; Al-Marrākushī 1984, p. 674).
En ce qui concerne les femmes des autres classes sociales, les parents les envoyaient souvent dans des écoles coraniques ( katātib ) pour apprendre le Coran et l’écriture (malgré l’opposition de certains fuqahā’). Les filles des autres classes qui pouvaient se permettre leur éducation étudiaient généralement les sciences religieuses plus que les autres matières, en particulier l’apprentissage et la mémorisation du Coran et du fiqh, tandis que les autres matières, telles que les sciences linguistiques, philologiques et rationnelles, ne les intéressaient pas beaucoup, à l’exception de celles qui les aidaient à comprendre les sciences juridiques ou qui avaient un rapport avec l’astronomie en raison de son importance dans la mesure du temps.
Rachid el Hour










